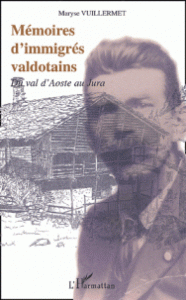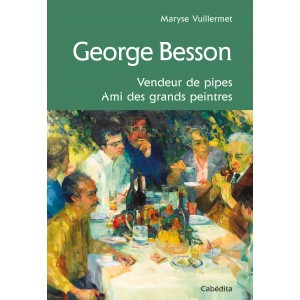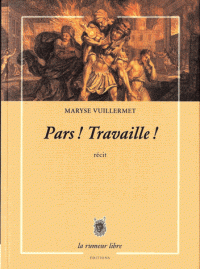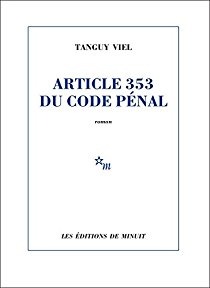Non, pas encore, pas encore, la panique quotidienne devant la fin du jour, que celui-là, celui-là ne se transforme pas en nuit, que cette soirée simple reste soirée. Assise dans le jardin, je retiens ce jour qui déjà grise le haut du cèdre et brouille la ligne fine de ses branches, le merle est encore tout fou mais le chat passe le mur et traverse, de très loin, il revient chez lui, il a senti lui aussi l’angoisse du soir, les voitures se précipitent sur les ralentisseurs, les travailleurs rentrent chez eux, en écoutant les radios. Je ne bouge pas. Je guette et je me demande ce que j’ai fait de ce jour-là, que tout cela ne coule pas entre mes doigts serrés. Je me suis levée tôt, j’ai bu un demi-litre de café, j’ai parlé à Alain, j’ai écrit un tout petit peu, préparé deux repas en un, mangé devant la télé, téléphoné à ma mère, mes filles, des amis m’ont appelée, j’ai organisé des petites sorties, enlevé des herbes au jardin, parlé à Alain, et le jour est fini, le cèdre est encore plus sombre, et le bas du mur noir, le flot des voitures ralentit, les chiens du fond de l’impasse ont aboyé, j’ai un peu froid, je reste immobile, je voudrais être si observatrice que je verrais passer les secondes, en « robes surannées comme les défuntes années ».
Non, pas encore, pas encore, la panique quotidienne devant la fin du jour, que celui-là, celui-là ne se transforme pas en nuit, que cette soirée simple reste soirée. Assise dans le jardin, je retiens ce jour qui déjà grise le haut du cèdre et brouille la ligne fine de ses branches, le merle est encore tout fou mais le chat passe le mur et traverse, de très loin, il revient chez lui, il a senti lui aussi l’angoisse du soir, les voitures se précipitent sur les ralentisseurs, les travailleurs rentrent chez eux, en écoutant les radios. Je ne bouge pas. Je guette et je me demande ce que j’ai fait de ce jour-là, que tout cela ne coule pas entre mes doigts serrés. Je me suis levée tôt, j’ai bu un demi-litre de café, j’ai parlé à Alain, j’ai écrit un tout petit peu, préparé deux repas en un, mangé devant la télé, téléphoné à ma mère, mes filles, des amis m’ont appelée, j’ai organisé des petites sorties, enlevé des herbes au jardin, parlé à Alain, et le jour est fini, le cèdre est encore plus sombre, et le bas du mur noir, le flot des voitures ralentit, les chiens du fond de l’impasse ont aboyé, j’ai un peu froid, je reste immobile, je voudrais être si observatrice que je verrais passer les secondes, en « robes surannées comme les défuntes années ».
Je voudrais les supplier de m’accorder un peu de répit, je vois le temps qui passe comme une étoile file, déjà dans l‘école, de l’autre côté du jardin, les femmes de ménage ont terminé et vont actionner les volets roulants, le voisin va venir fermer son portail, il ferme de plus en plus tôt, il fatigue Dino, il fatigue, il me l’a dit.
Moi, je refuse de fermer les volets, parce que de mon lit, je profite du jour jusqu’à son dernier souffle et le matin, les mésanges me réveillent quand il fait encore nuit.
Je sais qu’il faut lâcher prise, accepter la marche du temps, le passage des jours mais je m’arcboute, me révolte, je lutte, je ne me résigne pas.
J’ai froid, rentrer dans la maison, allumer les lampes et penser au repas du soir m’est une défaite insupportable.
Alors vite, réfléchis, où est la poésie de ta journée ? Le mot, le geste, la rencontre qui feront trace et dépôt dans ta mémoire. Tu n’as presque pas bougé de ton village mais de l’aube à ce soir frais, refais le tour en pensée, et égrène, trie, enrobe, tu prends le coup de fil à ta mère et tu gardes son rire, elle qui n’a presque jamais ri, dans sa grande vieillesse, rit souvent et pour un rien, c’est cadeau, puissant talisman.
Prends la conversation avec ton voisin, il a travaillé toute sa vie en haut d’une grue, il a 80 ans, vous ne parlez que du temps et du gel, mais chaque jour, il fait un effort, sort son sourire de petit garçon, son haussement d’épaule un peu adolescent, une expression, chaque jour, il cherche. Aujourd’hui j’ai dit je suis allée chez le dentiste ; il répond oh moi, je n’y vais pas, si j’y allais, il se sauverait en courant, il prendrait peur. Il a toujours quelque chose d’insolite à dire. Parfois, il marche jusqu’au bar au bout de la rue et s’assoit un moment tranquillement, parfois, il prend sa voiture et va voir ses copains gardiens de la déchetterie, et il revient avec une nième vieillerie, un aspirateur, une cafetière électrique, une petite télévision, un ventilateur, et il va la réparer dehors, debout, pour mieux guetter les passants et leur dire à chacun quelque chose de spécial auquel il réfléchit.
Et sa femme va hurler parce que, dans sa cour, il y a déjà trois, quatre tas, montagnes, piles recouverts de bâche en plastique, des planches, tôles, plaques de ferraille, pièces de toutes dimensions et formes, parce qu’il pourrait en avoir besoin. Donc retenir la bouche de Cha
Non, pas encore, pas encore, la panique quotidienne devant la fin, du jour, que celui-là, celui-là ne se transforme pas en nuit, que cette soirée simple reste soirée. Assise dans le jardin, je retiens ce jour qui déjà grise le haut du cèdre et brouille la ligne fine de ses branches, le merle est encore tout fou mais le chat passe le mur et traverse, de très loin, il revient chez lui, il a senti lui aussi l’angoisse du soir, les voitures se précipitent sur les ralentisseurs, les travailleurs rentrent chez eux, en écoutant les radios. Je ne bouge pas. Je guette et je me demande ce que j’ai fait de ce jour-là, que tout cela ne coule pas entre mes doigts serrés. Je me suis levée tôt, j’ai bu un demi-litre de café, j’ai parlé à Alain, j’ai écrit un tout petit peu, préparé deux repas en un, mangé devant la télé, téléphoné à ma mère, mes filles, des amis m’ont appelée, j’ai organisé des petites sorties, enlevé des herbes au jardin, parlé à Alain, et le jour est fini, le cèdre est encore plus sombre, et le bas du mur noir, le flot des voitures ralentit, les chiens du fond de l’impasse ont aboyé, j’ai un peu froid, je reste immobile, je voudrais être si observatrice que je verrais passer les secondes, en « robes surannées comme les défuntes années ».
Je voudrais les supplier de m’accorder un peu de répit, je vois le temps qui passe comme une étoile file, déjà dans l‘école, de l’autre côté du jardin, les femmes de ménage ont terminé et vont actionner les volets roulants, le voisin va venir fermer son portail, il ferme de plus en plus tôt, il fatigue Dino, il fatigue, il me l’a dit.
Moi, je refuse de fermer les volets, parce que de mon lit, je profite du jour jusqu’à son dernier souffle et le matin, les mésanges me réveillent quand il fait encore nuit.
Je sais qu’il faut lâcher prise, accepter la marche du temps, le passage des jours mais je m’arcboute, me révolte, je lutte, je ne me résigne pas.
J’ai froid, rentrer dans la maison, allumer les lampes et penser au repas du soir m’est une défaite insupportable.
Alors vite, réfléchis, où est la poésie de ta journée ? Le mot, le geste, la rencontre qui feront trace et dépôt dans ta mémoire. Tu n’as presque pas bougé de ton village mais de l’aube à ce soir frais, refais le tour en pensée, et égrène, trie, enrobe, tu prends le coup de fil à ta mère et tu gardes son rire, elle qui n’a presque jamais ri, dans sa grande vieillesse, rit souvent et pour un rien, c’est cadeau, puissant talisman.
Prends la conversation avec ton voisin, il a travaillé toute sa vie en haut d’une grue, il a 80 ans, vous ne parlez que du temps et du gel, mais chaque jour, il fait un effort, sort son sourire de petit garçon, son haussement d’épaule un peu adolescent, une expression, chaque jour, il cherche. Aujourd’hui j’ai dit je suis allée chez le dentiste ; il répond oh moi, je n’y vais pas, si j’y allais, il se sauverait en courant, il prendrait peur. Il a toujours quelque chose d’insolite à dire. Parfois, il marche jusqu’au bar au bout de la rue et s’assoit un moment tranquillement, parfois, il prend sa voiture et va voir ses copains gardiens de la déchetterie, et il revient avec une nième vieillerie, un aspirateur, une cafetière électrique, une petite télévision, un ventilateur, et il va la réparer dehors, debout, pour mieux guetter les passants et leur dire à chacun quelque chose de spécial auquel il réfléchit.
Et sa femme va hurler parce que, dans sa cour, il y a déjà trois, quatre tas, montagnes, piles recouverts de bâche en plastique, des planches, tôles, plaques de ferraille, pièces de toutes dimensions et formes, parce qu’il pourrait en avoir besoin. Donc retenir la bouche de Charles qui ferait s’enfuir un dentiste.
Et puis j’ai eu l’AMAP, l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne où je vais chaque semaine chercher mon panier. Le gars des fruits explique que ses pommiers ont gelé, et qu’il construit un nouvel hengar avec des murs en paille, il a besoin de volontaires pour le samedi, en paille ? je pense à la maison des petits cochons.
Et puis il y a Mitzou Pouget et Annie Fornelli, des camarades d’associations. Elles me racontent comment est morte la fille d’une autre amie. Elle était allée à une fête sur le campus de la Doye, et elle a voulu monter sur le toit d’une usine désaffectée, pour voir le soleil se lever. Quelque chose qui se fait à la fin des fêtes. Ses amis étaient fatigués, ils voulaient rentrer, ils n’ont pas voulu monter, son petit ami leur disait au revoir avant de grimper l’échelle, elle, elle s’est élancée la première et, en arrivant sur le toit, elle a dû trébucher. Parce que son petit ami a entendu son corps s’écraser juste à côte de lui. Non, ce n’est pas un suicide, elle a trébuché, ce n’était pas du tout son genre, elle était aventureuse et amoureuse de la vie, elle était partie un mois seule faire de la marche, elle faisait des tas de choses très audacieuses, elle n’avait peur de rien. Elles ont parlé des funérailles où le prêtre a réussi à déculpabiliser les parents.
Et voilà que ces deux événements suffisent, la nuit peut tomber désormais, le jour est plein, j’ai ce que j’appelle la poésie de ma journée, des faits uniques, la bouche de Charles et la chute de la petite qui voulait vivre si fort qu’elle avait, à vingt ans, déjà plus vécu que beaucoup mais elle a trébuché au moment où le soleil se levait.
Rentre, va faire chauffer la soupe, comme disait ta mère et réjouis-toi d’être là.
rles qui ferait s’enfuir un dentiste.
Et puis j’ai eu l’AMAP, l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne où je vais chaque semaine chercher mon panier. Le gars des fruits explique que ses pommiers ont gelé, et qu’il construit un nouvel hengar avec des murs en paille, il a besoin de volontaires pour le samedi, en paille ? je pense à la maison des petits cochons.
Et puis il y a Mitzou Pouget et Annie Fornelli, des camarades d’associations. Elles me racontent comment est morte la fille d’une autre amie. Elle était allée à une fête sur le campus de la Doye, et elle a voulu monter sur le toit d’une usine désaffectée, pour voir le soleil se lever. Quelque chose qui se fait à la fin des fêtes. Ses amis étaient fatigués, ils voulaient rentrer, ils n’ont pas voulu monter, son petit ami leur disait au revoir avant de grimper l’échelle, elle, elle s’est élancée la première et, en arrivant sur le toit, elle a dû trébucher. Parce que son petit ami a entendu son corps s’écraser juste à côte de lui. Non, ce n’est pas un suicide, elle a trébuché, ce n’était pas du tout son genre, elle était aventureuse et amoureuse de la vie, elle était partie un mois seule faire de la marche, elle faisait des tas de choses très audacieuses, elle n’avait peur de rien. Elles ont parlé des funérailles où le prêtre a réussi à déculpabiliser les parents.
Et voilà que ces deux événements suffisent, la nuit peut tomber désormais, le jour est plein, j’ai ce que j’appelle la poésie de ma journée, des faits uniques, la bouche de Charles et la chute de la petite qui voulait vivre si fort qu’elle avait, à vingt ans, déjà plus vécu que beaucoup mais elle a trébuché au moment où le soleil se levait.
Rentre, va faire chauffer la soupe, comme disait ta mère et réjouis-toi d’être là.