Tout à coup, on est à découvert dans le monde
 Tout à coup, on en a fini des
Tout à coup, on en a fini des
innombrables désirs, soifs , attentes, envies, désillusions, tout à coup, on descend et on ne trouve plus les
nœuds des troncs torturés, les nœuds dans les laines mitées, les nœuds dans les
phrases obscures, les hésitations aux carrefours, les peurs de.. les soucis de…
Tout à coup, il y a au fond de soi un petit lac pas trop
grand, eau claire, une minuscule plage, une
barque un peu vétuste, un arbre , pas un beau saule ni un chêne majestueux, non,
un frêne très humble, un jeune sureau,
il n’y a pas de monastère imposant de cellules, de cloitres à galeries et de moines savants, juste une petite chapelle, au
sol fait de grandes dalles branlantes, certaines sont gravées de noms, de disparus,
Et alors ? Ils le savaient, ils l’ont accepté.
Tout à coup, ce petit lac peut
être vaguement brouillé par une brise, où même traversé par un pédalo, une planche à voile, des enfants crient et s’éclaboussent.
C’était ça ! C’était ça et si peu, ce que tu attendais, craignais, tu as tant cherché et c’était là, au
bord du lac, une cabane aux planches délavées, une table et un lit, devant la cabane, une terrasse minuscule sur pilotis, un vieux est assis là, son visage est
entièrement ridé mais ses yeux sont rieurs.
C’était ça ! Et pourtant, tu
attendais toujours, à la fin d’une soirée, tout le monde parti, tu attendais
encore, après un livre, tu voulais en
commencer un autre, et les cerises cueillies, tu avais déjà la nostalgie de la récolte, le
dimanche soir, tu pleurais d’angoisse, et le 31 août, tu ne dormais parce que
l’été était fini. Mais la course s’est arrêtée, le sable soulevé par les chevaux,
les chars, les voitures est retombé, sur
la piste, assieds-toi, vieux berger, couvre
toi de ton burnous, reprends la contemplation des étoiles, tes cris rauques d’appels au troupeau, ta
canne, reprends ta pause à peine dérangée par la folle cavalcade qui a passé
comme un rêve !
C’était là et tu as mis tellement
de temps à arriver que le soir est presque tombé ; Où étais-tu partie ? Tu te cachais dans les bois, tu
étais seule dans les villes, individualité tremblante cherchant des noms de
rues, tu ne savais pas qu’au bord du lac, il y a toujours quelqu’un, les
planches de la cabane deviennent grises, les hirondelles sont moins nombreuses,
mais il est là, plein des vases des
années passées, plein des vies déjà transformées, il est là, frais,
vivant, rond, cours le monde, il
rafraichira ta soif, cours le monde, il apaisera ta fièvre. C’était ça, si
simple, si près, si facile et tu ne le
savais pas, tu allais ton train d’enfer,
tes désirs secs, tes joies pleines de larmes, te croyant satisfaite, tu allais, fermée et toujours déçue.
Mais soudain, une tendresse de
petite fille câline te déborde, n’aies pas honte, cours avec les autres
enfants, cours dans l’eau heureuse.
 Un petit groupe, un collectif, se réunit juste pour se lire des textes, les faire résonner, en parler, les partager, les génisssons parqués non loin se sont rapprochés, ont formé un éventail, et semblaient écouter, les grenouilles ont commencé à répondre vers vingt et une heure, et on a appris que l’expression « entre chien et loup » avait beaucoup intrigué Jean-Paul Kauffmann.
Un petit groupe, un collectif, se réunit juste pour se lire des textes, les faire résonner, en parler, les partager, les génisssons parqués non loin se sont rapprochés, ont formé un éventail, et semblaient écouter, les grenouilles ont commencé à répondre vers vingt et une heure, et on a appris que l’expression « entre chien et loup » avait beaucoup intrigué Jean-Paul Kauffmann.
 Une réflexion qui rassure, fait du bien, montre que le temps est une notion fabriquée, comptée, pour mieux nous exploiter, et que se placer dans le flux, et non s’arcbouter contre, vivre le présent est la meilleure façon de se déprendre de son angoisse.
Une réflexion qui rassure, fait du bien, montre que le temps est une notion fabriquée, comptée, pour mieux nous exploiter, et que se placer dans le flux, et non s’arcbouter contre, vivre le présent est la meilleure façon de se déprendre de son angoisse.
 Tout à coup, on en a fini des
Tout à coup, on en a fini des P 85 « Claude Duneton, il est à sa table dix heures par jour. J’avoue qu’il m’a rendu honteux moi qui ne peux écrire que le temps d’une courte après-midi
P 85 « Claude Duneton, il est à sa table dix heures par jour. J’avoue qu’il m’a rendu honteux moi qui ne peux écrire que le temps d’une courte après-midi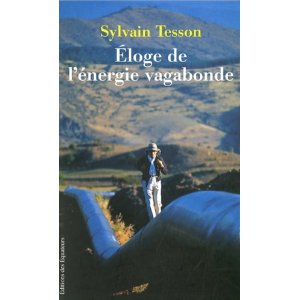 « L’énergie déserte les êtres qui connaissent trop bien les labyrinthes de leur vie, ceux qui n’attendent plus rien des instants à venir, et ceux, qui par peur, de l’inattendu s’enferment dans le mur de l’habitude. A chaque tic-tac de l’horloge du temps, les parois leur renvoient l’écho du tic-tac précédent au lieu de leur chanter la musique de l’inconnu. Pour avancer dans le couloir du temps, il faut donc choisir son camp en saisissant son arme : soit un bouclier frappé au blason de l’habitude, soit une épée tranchante pour faucher l’obscure lumière de l’imprévisible.
« L’énergie déserte les êtres qui connaissent trop bien les labyrinthes de leur vie, ceux qui n’attendent plus rien des instants à venir, et ceux, qui par peur, de l’inattendu s’enferment dans le mur de l’habitude. A chaque tic-tac de l’horloge du temps, les parois leur renvoient l’écho du tic-tac précédent au lieu de leur chanter la musique de l’inconnu. Pour avancer dans le couloir du temps, il faut donc choisir son camp en saisissant son arme : soit un bouclier frappé au blason de l’habitude, soit une épée tranchante pour faucher l’obscure lumière de l’imprévisible.



 Des hommes et des femmes qui ne connaissant pas l’électricité, ni la télévision, ni la radio, n’ont jamais eu de moto, encore moins de voiture, ni de motoculteur, n’envoient pas leurs enfants à l’école parce que c’est trop cher, ne lisent pas de livres ni de journaux, se marient dans leur milieu et travaillent jusqu’à leur mort. Et pourtant, ils sont gais, ils rient, ils plaisantent, sont élégants comme des princes, sortent des cases poussiéreuses avec des pantalons repassés, des chemises immaculées, les femmes portent des robes avec des cols de dentelles très blanc, Comment font-ils?
Des hommes et des femmes qui ne connaissant pas l’électricité, ni la télévision, ni la radio, n’ont jamais eu de moto, encore moins de voiture, ni de motoculteur, n’envoient pas leurs enfants à l’école parce que c’est trop cher, ne lisent pas de livres ni de journaux, se marient dans leur milieu et travaillent jusqu’à leur mort. Et pourtant, ils sont gais, ils rient, ils plaisantent, sont élégants comme des princes, sortent des cases poussiéreuses avec des pantalons repassés, des chemises immaculées, les femmes portent des robes avec des cols de dentelles très blanc, Comment font-ils?