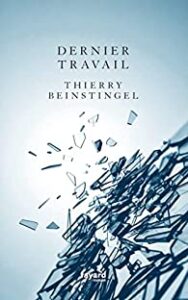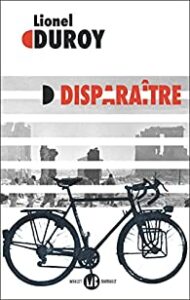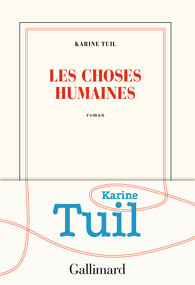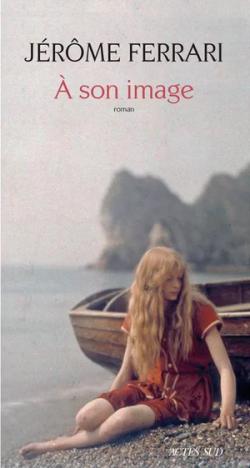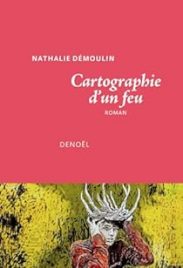
Grâce à Arno Bertina, j’ai lu Cartographie d’un feu de Nathalie Démoulin, qui vient d’être publié chez Denoël.
Une cluse jurassienne aux parois abruptes et noires d’épicéas et de roches, des pentes vertigineuses en hiver et la neige elle aussi devenue noire parce qu’un feu se propage. Pourquoi ce feu ? S’est-il développé sur des poches de pétrole inconnues ? Pourquoi la Terre brûle-t-elle en hiver ? En tout cas dans ce décor halluciné et dantesque, les hommes luttent.
Le narrateur et sa compagne Carole se réfugient dans une maison de famille isolée. Cette maison de famille est habitée et hantée par les fantômes et les vivants. Le patriarche Jason, présent et absent, ancien capitaine d’industrie devenu peintre, avait déjà perdu une première femme et deux enfants dans un incendie, il y a longtemps. Désormais, il veille sur le dernier fils, fou qui se balade au bord du lac, avec des bois de cerf sur la tête. Il tente d’oublier sa deuxième épouse, une marathonienne qui a formé à la course et au saut à ski leur fils avant de disparaitre.
Mais on ne s’envole pas hors de cette cluse, on y reste, comme frappé de stupeur, ou on y meurt.
En effet, le feu ne s’éteint pas et provoque d’autres morts. Un maire, autour de qui tout s’écroule, se suicide, oubliant ainsi la dette qu’il a accumulée pour sa ville.
Et au milieu du cercle de l’enfer, un lac opaque, noir qui attire et peut noyer.
L’écriture de Nathalie Démoulin est précise, elle excelle à créer des images puissantes et envoutantes, pour décrire la montagne, la neige, la cluse, le feu, les maisons pleines de tapis, de tapisseries, et de tableaux, les hommes et les femmes affublés de tenues bizarres, tout est brûlant de couleurs. On y retrouve un des thèmes très original de Bâtisseurs de l’oubli, celui du capitaine d’industrie, dont la puissance n’apaise pas la mélancolie.
Et on ne sait plus près de quelles frontières elle nous entraîne, on confond réalité et cauchemars, souvenirs et faits présents, réapparitions et disparitions, fuites ou morts.