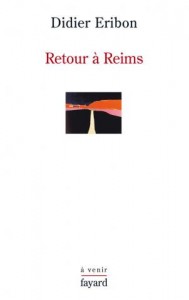Bonnes à tout faire, même dans le roman
Dans tous les romans du 19° et du 20°,un personnage passe et repasse discrètement, presque transparent, il est toujours là, au milieu de la famille et de la maison, dans le salon, auprès des enfants, dans la chambre à coucher, aux côtés du personnage principal, au mieux confident, presque toujours personnage secondaire, sans description physique ni psychologique. Ce personnage, c’est la bonne à tout faire, la servante. Ou la domestique. Son statut social est ambigu et sa représentation hésitante. En effet, ce n’est pas une femme du peuple car elle vit dans l’univers bourgeois et en adopte les codes, ni une femme de la campagne car elle en est partie, ni une épouse ou une mère car le célibat est pour elle quasi-obligatoire, c’est un personnage entre deux mondes et sa place est embarrassante pour le romancier. Hésitant entre l’ignorance et la caricature, entre le non-dit et la provocation, il a longtemps cherché une façon de présenter le personnage et de parler d’elle.
Car c’est aussi un personnage sans voix, comme le dit Anne Martin-Fugier: « Les domestiques sont muets. »?qui est donc toujours représenté et donc fantasmé par ceux-là même qui les emploient, les écrivains bourgeois.
Je ferai porter mon étude principalement sur la bonne de ville, la bonne citadine, venue de la campagne et de la province pour s’engager dans les grandes villes, Paris principalement.Je n’évoquerai donc pas ou peu les personnages de servante de ferme, fille de ferme, la première étant Geneviève de Lamartine suivie par de nombreux personnages de Maupassant. D’une part, le corpus est vaste et il faut le limiter, et, d’autre part, la problématique est différente, la fille de ferme ne change pas de milieu, elle garde la même mentalité, les mêmes distractions, la même morale, née dans une ferme et souvent fille de paysans,elle est envoyée dans une autre ferme et elle ne quitte guère sa région, les déplacements sont limités et elle n’a pas à connaître le déracinement social bien sûr mais aussi géographique et culturel des bonnes des grandes villes.
L’étude sociologique et historique du personnage a été magistralement menée par Anne Martin-Fugier. Comme beaucoup d?historiens, elle s’appuie sur des documents littéraires, utilisés comme sources documentaires pour décrire les conditions de placement, les places, les gages, les tâches, le logement, les loisirs, la vie sexuelle et les représentations le plus souvent fantasmées, imaginaires des écrivains de l’époque tous bourgeois et employant des bonnes. Nous nous servirons donc de son travail très riche de recherche, de repérage et de nomenclature de l’ensemble des romans mais cette étude nous amènera à nous poser d’autres questions: non pas la place de la bonne dans la société mais sa place dans le roman, la question du statut romanesque du personnage, ses fonctions suivant les genres et les époques et enfin sa description physique et psychologique.
Dans la littérature populaire des feuilletons, le personnage de la bonne est très peu représenté. Certes, comme l’a montré Michel Nathan, de très nombreux romans sont construits sur le motif de la fatalité liée à la féminité. L’héroïne violée ou courtisée et séduite puis chassée va connaître une multitude d’épreuves avant de retrouver honneur, enfant et bonheur. Mais, pour qu’ une lectrice populaire d’origine sociale moyenne puisse s’identifier à l’héroïne, elle ne doit pas être trop marquée socialement et située trop bas dans l’échelle sociale. L’héroïne de ces romans est jolie, honnête, en général de la moyenne bourgeoisie ou de la petite noblesse. Son parcours l’amènera parfois à travailler très dur (voir La porteuse de pain) ou même à se prostituer (chez Decourcelle dans Chaste et flétrie) mais elle n’est pas à l’origine bonne et ne le devient jamais à la fin de son errance. Presque aucune bonne visible dans la littérature populaire donc, mais, à l’inverse, on trouvera ce thème de la fille-mère jetée à la rue et errante, enceinte ou avec son enfant, très étroitement lié et comme consubstantiel du personnage de la bonne. Chaque fois que ce personnage est évoqué, on a, pas très loin, presque toujours un enfant adultère. La différence, c’est que cette abominable épreuve qui se termine bien dans la littérature populaire et fortifie ou bonifie l’héroïne qui avait déjà au départ toutes les qualités, au contraire, détruit et conduit à sa perte la bonne dans presque tous les autres genres.
Dans la littérature réaliste et naturaliste de la fin du XIX°, la bonne à tout faire est surtout un personnage secondaire, fidèle présence aux côtés de sa maîtresse, Vingt-neuf cas cités dans le dictionnaire thématique du roman de mœurs de Hamon et, si l’on recense les romans populaires, on en trouvera encore plus. Mais cet effacement est parfois trompeur et recèle des surprises au lecteur. Je ne prendrai que deux exemples, Céleste dans La Curée de Zola 1882,et Rosalie dans Une vie de Maupassant 1883, deux personnages très secondaires. Céleste dans la Curée n’est pas décrite physiquement, elle est mentionnée seulement. Les amants maudits, belle-mère et beau-fils vivent, parlent, s’embrassent, se déshabillent en sa présence comme si elle était invisible. Rosalie est décrite au début du roman de Maupassant mais uniquement physiquement, « une grande fille forte et découplée comme un gars. ». Mais peu à peu, au fur et à mesure que le personnage principal se délite jusqu’à la déchéance morale et la ruine financière chez Zola et jusqu’à la solitude et la pauvreté chez Maupassant, en contre-point, le personnage de la bonne prend de l?importance et s’affirme.
Dans La Curée, c’est quand la débauche et les folles dépenses ont réduit Renée, l’héroïne principale, à la solitude, à la toute fin du roman, qu’elle s’aperçoit que Céleste existe, est toujours là et qu’elle croit que la familiarité qui la lie à elle est de la tendresse, qu’elle croit même l’aimer.Dans l’écroulement de ses tendresses, il vint un moment où Renée n’eut plus que sa femme de chambre à aimer. »Elle est persuadée que ce sentiment est réciproque et que sa bonne lui fermera les yeux et, c’est à ce moment-là que la bonne lui annonce froidement qu?elle dispose, à compter de ce jour, de 5000F, assez pour s’établir, acheter deux vaches et un petit commerce et qu’elle ne restera pas un jour de plus. Dans Une vie de Maupassant, l’héroïne est Jeanne, elle a rêvé d’un amour romantique et elle épouse un goujat qui la trompe dès le jour de son arrivée au château avec la petite bonne. Elle avait rêvé d’être mère et elle l?’st exactement en même temps que sa bonne et du même homme, son mari. Elle avait rêvé de finir ses jours dans le château de ses parents et, ruinée par son fils, elle doit le vendre et habiter dans une demeure très modeste. Sa bonne Rosalie, décrite dans « ses songeries? animales, » un peu comme un animal familier est mariée sans son consentement avec un paysan pour étouffer le scandale de son engrossement par le maître. Et puis, à la fin du roman, renversement de situation, c’est la bonne Rosalie qui vient s’occuper de Jeanne, gérer ses derniers sous, élever sa petite fille orpheline. On a donc dans les deux romans une série d’oppositions qui mettent en valeur les déchéances des héroïnes:
L’héroïne / La bonne
Fine et jolie / hommasse, grossièrement charpentée
Fragile /solide
Rêveuse et romanesque
Sensible /songeries animales, silence ignorant, têtue
Heureuse /exploitée,
Comblée et oisive /travaillant dur
Courtisane et mariée /engrossée ou célibataire
imprévoyante/économe et bonne gestionnaire
Et toutes ces oppositions s’inversent brutalement et mettent en relief des fins pathétiques pour les héroïnes, d’autant plus pathétiques que ce sont leurs propres domestiques qui leur viennent en aide.
Les maîtresses n’ont plus rien, ne sont plus rien et les bonnes émergent, acquièrent identité
et personnalité.
« Vieilles et perdant leur beauté, elle vieillissait, ses yeux se cerclaient de bleu//Rosalie, le visage frais et souriant
Rêverie apathie et folie/ bon sens, faisant la morale à leur patronne
Fragilité devenue faiblesse incapacité à s’assumer / riches, possédantes
Oisives toujours / actives mais pour elles-m?mes
Seule /insérées socialement, Rosalie a un fils aimant, Céleste va acheter un commerce.
Tous les défauts de classe des maîtresses sont mis en valeur par les qualités de leurs domestiques, leur destin suit une courbe de bonheur ascendante qui redescend brutalement alors que celle de leur bonne monte insensiblement mais sûrement. Procédé très efficace, contraste saisissant, le personnage de la bonne dans l’économie du récit est utilisé par l’auteur comme un révélateur, un marqueur. Il n’est pas décrit pour lui-même mais il montre mieux qu’un long discours et indirectement, la déchéance morale et physique de la bourgeoisie et, peut-être, la capacité du peuple à s’en sortir, à s’élever socialement et à garder ses propres valeurs. On observe le même retournement dans un autre roman de Zola, Nana, la domestique part riche de chez Nana ruinée et ouvre un bordel de luxe.
Dans Pot-bouille de Zola publié en 1882, l?auteur met en scène une foule de bonnes, dresse une importante galerie de portraits, décrit avec une précision documentaire chaque chambre de bonne du long couloir au sixième étage d?une maison bourgeoise. Ce roman présente dans une symétrie fascinante les habitants d’un immeuble parisien, chaque famille et sa bonne, les familles logeant dans les appartements et les bonnes à l’étage des bonnes. Dans ce roman naturaliste, la construction dramatique est magistrale, fonctionnant sur le contraste entre l’envers et l’endroit, le décor et les coulisses, la façade et l’intérieur. Premier contraste: les bourgeois empruntent le grand escalier, les bonnes passent par l’escalier de service et bavardent en prenant l’air sur la cour des cuisines, un égout où elles jettent les ordures du ménage mais aussi les ordures de leurs commérages sur leurs patrons et où les patrons ne sont jamais. Les bourgeois présentent bonne figure à l’extérieur et dans le monde mais, en privé, et avec leurs bonnes, ils sont avares, cruels, concupiscents, menteurs, arrivistes, adultérins, mauvais parents. Leurs bonnes qui les voient dans leur intimité les connaissent et les jugent pour ce qu’ils sont: »Je suis qu’une bonne mais je suis honnête. Et il n ‘y a pas une de vos garces de dames qui me vaille dans votre baraque de maison. »Domestiques plus honnêtes que les maîtres, première inversion de rôles.
Mais les bonnes ne sont pas idéalisées, sous leur air sérieux et en cachette de leurs maîtres, elles ont toutes des vices horribles, Victoire boit, Lisa fait la bombe et dévoie la jeune fille de la maison, Rachel vole de l?argent et fait chanter sa maîtresse. Cependant, comme le fait remarquer le préfacier M A Voisin Fougère, La sympathie de l’auteur leur est acquise; d’ abord, c’est à une bonne que revient la réplique finale, toutes les baraques se ressemblent c’est cochon et compagnie. Et ensuite, les bonnes ne sont pas aussi hypocrites que leurs maîtres, elles n’ ont pas à défendre les apparences des convenances, c’est leur condition qui les conduit à ces échappatoires. Le roman se termine sur un contrepoint cruel et longuement tenu par Zola. La petite bonne Adèle accouche seule dans sa chambre terrorisée et malade d’un enfant qu’elle abandonnera. Cet enfant est l’oeuvre d’un des hommes de la maison, le père ou le fils, on ne sait pas et pendant ce temps, au même moment, chez les mêmes, les Duveyrier, se tient une brillante réception, le probable père de l’enfant se pavanant devant ses hôtes dans un discours moralisateur. Aucun réalisme, au contraire une construction artificielle et savante où les personnages de bonnes sont? chargées de dévoiler crûment l’envers des apparences morales de leurs patrons.
Dans le roman populiste du début du siècle chez Frapié par exemple, le personnage de la bonne a un peu la même fonction. Dans La proscrite, publié en 1900, les mentalités ont un peu évolué, le manque de personnel est crucial, la bonne devient rare. Toutes les dames militent dans des associations caritatives en faveur des domestiques. Ce qui ne les empêche pas de s’en plaindre constamment: » Ma bonne est une coureuse finie mais tant pis je la garde, elle est propre, ne me vole pas et fait bien la cuisine. » L’intrigue se noue autour du fils de la maison qui veut faire carrière. Sa mère recommande une jeune fille pauvre de leur connaissance, Virginie, à une famille amie dont le fils est notoirement dépravé, qui n’arrive pas à conserver son personnel mais dont l’influence politique est certaine et vaudra au fils de la maison une bon début de carrière. Ce service est comparable à un joli cadeau. »et vaudra au personnage principal un poste de secrétaire de ministre. Et vaudra à Virginie la déchéance, ce que tout le monde avait prévu et accepté. Enceinte, elle est chassée et accouche à l’hôpital avant de mourir d’épuisement. Le héros est conscient du prix de sa réussite, « ce qu’il faut en consommer de la féminité pour faire un homme important. » mais sans remords. Le narrateur adoucit un peu son propos, le bébé aura pour marraine la vieille fille de la maison. Le manque de personnel, sa rareté devient un enjeu romanesque, le personnage de la bonne, son destin servent ici la critique sociale de l?auteur, les bourgeois sont prêts à tout pour faire une carrière dont la première marche est le corps d?une jeune bonne..
Venons-en maintenant aux quelques grands et rares romans qui ont pour personnage principal une bonne, Une servante d’autrefois de Zulma Carraud, La Grande Maguet de Catule Mendès , Un cœur simple de Flaubert, Germinie Lacerteux des frères Goncourt et Le journal d’une femme de chambre de Mirbeau. J’emploie le terme roman pour Le journal d’une femme de chambre car le caractère fictionnel du récit et sa construction narrative ne font plus de doutes pour les critiques.
A très gros traits, on observe deux types de bonne, la servante au grand cour, dévouée et fidèle jusqu’à la mort, cette série avait été inaugurée par Geneviève de Lamartine, et la bonne monstrueuse, cumulant vices et souillures. Cette série sera fermée par Les bonnes de Genet.
Les bonnes dévouées sont celles de Lamartine, Flaubert et Zulma Carraud. Et les bonnes délurées sont celles de Mendès, Goncourt, et Mirbeau. Lamartine par humanisme chrétien et charité, et Flaubert, par souci de réalisme, ont choisi des personnages du plus bas de l’échelle. Leurs personnages sont des bonnes rurales, dévouées toute leur vie à la même famille, assistant à la naissance des enfants, fermant les yeux des aïeules, et mourant seules mais avec le sentiment du devoir accompli. Elles représentent l’idéal de bonne, celles que souhaitent toute famille. Leur sanctification est assurée.
L’autre catégorie comprend les bonnes parisiennes des Goncourt et de Mirbeau par exemple.
Pourquoi ces auteurs décident-ils de faire de la bonne le personnage principal? Les Goncourt n?expliquent pas vraiment ce choix, ils veulent « montrer les misères. Ecrire un roman vrai. » On sait qu’ils avaient été choqués par l?histoire de leur propre bonne dévouée toute sa vie à la famille et qui à, sa mort, révèlera une double vie, des dettes et des orgies, des vols pour entretenir ses amants.Mirbeau ne donne pas non plus ses motifs précis de camper ce personnage.
Quels buts poursuivent-ils? Les Goncourt se servent du document humain, l?histoire de leur propre bonne, Rose Malingre. Ils font un récit détaillé et complet et une analyse sociologique très poussée du milieu, l’origine sociale, le bureau de placement, les bals, les bars, les lieux de promenade, le travail, les tâches. Ils font également une analyse psychologique très fouillée du personnage, montrant les angoisses, la misère affective, l’adoration de Germinie pour sa maîtresse, puis le terrain, les mécanismes et les effets de l’ hystérie et enfin l’alcoolisme, la nymphomanie. Le roman se caractérise par l’ absence d’ explication, ils nous montrent Germinie dans sa vie, ses gestes, ses actions. Il nous décrit ses amours qui l’ entraînent toujours plus loin dans le don de soi et la déchéance sa maladie et enfin sa mort. Il nous montre l’absence de tombe, l’absence de nom et de dates. Germinie enterrée dans la fosse publique, morte n’existe plus, elle est effacée de la terre.
Ultime étape, Le journal d?une femme de chambre fait dire » je » pour la première fois à une servante. Mais cette voix présentée par la préface comme authentique se révèle très vite fictive, cette servante s »exprime comme un écrivain, comme Mirbeau, pour lui. Ce livre, même s’il décrit avec une grande précision qui relève de beaucoup d’observations et de sympathie, l’univers des domestiques permet surtout à Mirbeau de cracher sa haine de la bourgeoisie, son amour de la sexualité et son anarchie. Cette femme de chambre intelligente, observatrice, hardie et perverse, menteuse, hypocrite, aime le plaisir sexuel, la force des vrais hommes et rêve de devenir à son tour une femme riche et respectée. En plus de citer avec une visible jouissance toutes les formes de l’érotisme, fétichisme, inceste, homosexualité féminine et masculine, pédophilie, bestialité, nécrophilie, masochisme Mirbeau d?nonce toutes les tares et les injustices de la société. Pour autant, il n’idéalise pas du tout les serviteurs. Comme Zola, comme Goncourt, il en montre les bassesses, les médisances, les vols, les chantages, les cruautés.? Célestine devenue patronne grâce à un vol est aussi méprisante et cruelle avec ses propres employés que l’ont été avec elle ses anciens maîtres.
Il est donc intéressant de constater que l’écrivain du XIX° et du d?but du XX?° n’a d’autre choix que d’assimiler la bonne à Marie ou Madeleine. Soit elle est sainte et sanctifiée mais dans ce cas-là, elle meurt seule, sans enfants, sans famille, soit elle est chargée de tous les vices et a une fin pathétique et sordide. Ce personnage n’existe pas pour lui-même en tant que personnage à part entière. Il n’a ni identité propre, ni passé, ni avenir, ni descendance. Ce vide identitaire est comblé dans la narration par des rêves ou des fantasmes, rêves de la sainte ou fantasmes sexuels de la femme offrant aux hommes toutes les perversions sexuelles.
Pourtant, un roman fait exception et sort de ce manichéisme caricatural, c’est Donatienne de René Bazin.. Le titre est éponyme, Donatienne est le nom du personnage principal, une bonne bretonne et le roman est son histoire, l?histoire d’une jeune bretonne mariée et mère de famille qui part à la ville comme nourrice pour aider financièrement son mari et ses enfants. Happée par le tourbillon des conversations des autres bonnes, par leur amoralité, enivrée par le luxe, l?argent gagné sans efforts, elle oublie les siens et devient la maîtresse d’un valet déluré. Son mari chassé par la misère de sa ferme erre sur les routes avec les trois enfants et finit par échouer en Auvergne où il travaille comme manœuvre dans une carrière. La jolie Donatienne abandonnée par le valet et ayant perdu son emploi vit tristement avec un patron de bar ivrogne et brutal. Elle raconte son histoire à un voyageur qui, par le plus grand des hasards, fait le rapprochement avec une famille sans mère qu?il avait vue en Auvergne. Entre temps, le mari a perdu une jambe dans un accident du travail. Donatienne reprend son baluchon et revient auprès des siens. C’est donc un personnage complexe et très humain avec ses failles et son courage. Ce personnage a parcouru un cycle de vie et de réflexions. Désir de fuir l’enfermement et la misère de la campagne, fascination de la ville et du luxe, oubli et mépris de son origine et de ses valeurs, échec, malheur, remords, solitude, remise en cause puis décision et enfin retrouvailles avec les siens et sa culture. La coiffe bretonne étant le symbole de son appartenance culturelle, elle la retire sous les moqueries des camarades en arrivant à Paris et la remet quand elle retrouve les siens. Ce roman, certes moraliste, s’attache à décrire, comme ceux des naturalistes, la condition sociale des bonnes, leurs logements, les bureaux de placement mais s?attarde aussi sur l’intériorité, la psychologie de Donatienne et surtout la complexité de son cheminement. La chute et la rédemption réunissent en un même personnage les figures de Madeleine et de Marie et lui confèrent une richesse qui l’éloigne de la caricature.
Qu?en est-il au XX? siècle ?
Peu de repr?sentations, Les bonnes de Jean Genet, une pièce de théâtre, et Le square de Marguerite Duras.
Dans Le square de Duras 1955, deux voix se répondent, celle d’une jeune fille et celle dun voyageur de commerce, pas d’ identité, pas de lieu, pas de temps précis. A la première personne du singulier, la jeune fille parle de ce qui l’occupe, de son métier, et surtout de ses rêves de rencontre et de mariage. Elle définit son métier comme quelque chose de transitoire, qui doit disparaître complètement, comme s’il n?avait jamais existé.
« Mon état n?est pas un état qui puisse durer. Il est dans sa nature de se terminer tôt oi tard. J’attends de me marier, Et dès que je le serai, c’en sera fini pour moi de cet état. »Plus loin, elle revient encore sur cette idée: « Ce n’est pas un métier que le mien. On l’appelle ainsi pour simplifier. Ce n’en est pas un, c’est une sorte d’état, d’état tout entier vous comprenez comme d’être un enfant ou d’être malade. Alors cela doit cesser. »Duras en quelques mots a dit la spécificité de la bonne, un faux métier, un état transitoire, une situation au sein d?une famille étrangère forcément éphémère, un état qui disparaîtra forcément.
Dans Les bonnes de Jean Genet, on retrouve la catégorie » bonne monstrueuse ». Dans Le journal d?une femme de chambre de Mirbeau, Célestine évoquait déjà à plusieurs reprises l?envie de tuer ses maîtresses mais elle ne passait pas à l’acte. « Quelquefois, en coiffant mes maîtresses, j’ ai eu l’envie folle de leur déchirer la nuque, de leur fouiller les seins avec mes ongles. »Ou » Quand je pense qu’ une cuisinière tient, chaque jour, dans ses mains, la vie de ses maîtres, une pincée d’arsenic à la place du sel, un petit filet de strychnine au lieu du vinaigre? et ça y est! Eh bien non faut-il que nous ayons, tout de m?me, la servitude dans le sang. » Dans la pièce de Genet, un tabou est franchi, les bonnes passent à l’acte. Peut-être le fait d’être deux, deux sœurs, deux alliées leur a-t-il donné la force de tuer leur maîtresse?
Au XX? siècle, le métier de bonne disparaît peu ? peu, ses tâches étant distribuées à différentes professionnelles : la femme de ménage, la nourrice agréée. Ces professionnelles ne vivent pas dans la famille et y sont beaucoup moins? impliquées. Le personnage littéraire peu à peu disparaît du paysage romanesque. Un roman de C. Oster s’intitule d’ ailleurs La femme de ménage.
On a donc vu comment le personnage de la bonne passe du statut de personnage invisible ou secondaire, à celui de personnage révélateur ou faire-valoir du personnage principal puis à celui de personnage principal très manichéen et essentiellement vecteur d’idées chrétiennes ou d’idées anti-bourgeoises et enfin, très tardivement et très rarement, personnage à part entière présentant une certaine épaisseur et complexité psychologiques et comment il disparaît peu à peu du paysage romanesque du XX ° siècle.
Esquissons maintenant un rapide portrait du personnage tel qu’il apparaît dans ces textes. Sur le plan physique, ce qui est noté le plus souvent, c’est sa robustesse, sa solidité, sa résistance et en corollaire son absence de finesse, de beauté allant jusqu’à la laideur.
Son origine sociale n’est mentionnée que dans ses conséquences: venant de la campagne et de la ferme, elle est maladroite, sale, elle sent mauvais, ne connaît pas l?hygiène. Elle est ignorante de tout ce qui fait le raffinement d’une maison et d’une table bourgeoise, le service, la cuisine soignée, le soin du linge. Son langage est grossier et parfois patoisant .Elle est souvent très jeune ou assez âgée.
Sur le plan psychologique, le portrait sunifie. Le déracinement g?ographique et social conduit à une perte de repères. Imaginez une jeune fille venue d?un autre monde confrontée à de telles différences d’habitudes, de mode de vie et de culture, abrutie de fatigue et de manque de sommeil et on en fait une niaise .On la décrit comme égarée, passive, hébétée. Ce qui va jusqu’à la stupidité si souvent révélée par le personnage de Bécassine popularisé par le magazine la semaine de Suzette au début du siècle.
Un autre facteur noté très souvent est la grande solitude affective de ces jeunes filles. Solitude plus ignorance qui les conduit à des attitudes récurrentes, rechercher la compagnie des autres bonnes, bavarder sans fin sur les patrons, courir les bals, coucher avec le premier homme qui leur adresse une parole gentille ou humaine ( Une vie, Germinie Lacerte, Pot-Bouille, La proscrite), confondre désir sexuel et amour, et s’adonner à la débauche comme recherche éperdue d?amour, croire à toutes les promesses de mariage. Autre attitude:reporter tout ce besoin d’ amour, s’ attacher douloureusement et un peu névrotique ment à ses maîtres, (Germinie, la grande Maguet, la proscrite) et confondre leur humanité é ou toute marque d’ intérêt avec un réel attachement. Celles-là se perdent mentalement et physiquement et meurent dans la misère et l’ anonymat.
Les plus résistantes mentalement vont mener pendant des années une double vie psychologique. Devant les maîtres, silence, dévouement parfois même adhésion à leur mentalité et au fond d’elle, un mépris violent de tout ce qu’elles voient, un attachement très fort à leur milieu, à sa morale ce qui fait que le jour venu, quand elles sont assez riches, elles peuvent quitter maîtres et monde de leur maître sans regret.
Le problème, c’est que revenue dans leur village, leur campagne et leur milieu, elles ont tellement changé qu’on ne les reconnaît plus. Façon de s’habiller, goût, façon de parler, mépris des anciennes manières, tout les différencie. A nouveau étrangères mais chez elles cette fois.
C’est donc une rencontre rare ou une absence de rencontre entre toutes ces femmes et le romancier qui les côtoyait. Si le romancier avait bien voulu s’y intéresser, il aurait constaté qu’ elles révèlent une grande complexité psychologique et qu’elles sont des personnages à part et difficilement classables. Premières immigrées de l?intérieur, premières déclassées, premières femmes de leur milieu à partir, à gagner de l’argent, à faire des projets pour elles-mêmes, ces pionnières sont des personnages éminemment romanesques et modernes. Jamais entièrement soumises, jamais non plus suffisamment révoltées ou revendicatives, jamais entièrement petites bourgeoises mais en gardant les goûts et les manières de leurs patrons, plus jamais totalement femmes du peuple, elles sont entre deux mondes, entre deux cultures et le romancier n’a su bien souvent que les ignorer ou les caricaturer. Tantôt fasciné par ce qu’il prenait pour de l’animalité ou de la sensualité et qui n’était que de la sauvagerie et de l’ignorance, tantôt horrifié par sa saleté et sa vulgarité, tantôt admirateur de son dévouement mais peu curieux de ce qu’il y avait derrière, son identité et sa solitude, surpris que ce dévouement prenne fin, le romancier ne lui donne jamais un vrai rôle. Chargée de vanter la morale chrétienne, ou de révéler les turpitudes bourgeoises et?? d’en assener une critique acerbe, voire d’assouvir les fantasmes sexuels de l’écrivain, les bonnes ont servi à tout, bonnes à tout faire, même dans le roman, mais n’ont pas été suffisamment reconnues comme personnages riches et coùmplexes
Bibliographie
Romans
Lamartine, Geneviève, histoire d?une servante, 1850, Editions R Simon ,1936
Zulma Carraud, Une servante d?autrefois, Hachette 1869
Maupassant, Une vie, 1883, Gallimard? 1974
Edmond et Jules de Goncourt, Germinie Lacerteux, 1864, G.F. Flammarion 1990
Zola, La curée, 1872, Livre de poche, 1965.
Pot-Bouille, 1882, Livre de poche, 1998.
Nana, 1880.
Octave Mirbeau, Journal d?une femme de chambre, Fasquelle 1900, Gallimard 1984 pour l’édition utilisée
Bazin, Donatienne, Calman-Levy, 1903.
Bécassine, La semaine de Suzette.
Victor Margueritte, Prostituée, 1907.
Léon Frapié, La figurante, Calman-Levy, 1908.
La proscrite, Calman-Levy
Les bonnes, Jean Genet, Decines, 1947
Duras, Le square, 1955, Gallimard
Maria Arondo, Moi la bonne, Entretiens, Stock, 1975
Christian Oster La femme de ménage,
Essais et critique
Corbin, les filles de noce, Misère sexuelle et prostitution au XIX° siècle, Champs Flammarion
Philippe Hamon Alexandrine Viboud, Dictionnaire thématique des romans des mœurs,? Presses Sorbonne Nouvelle, Article domestique
Anne Martin-Fugier, La place des bonnes, La domesticité féminine, Paris en 1900, editions Fasquelle1979, Editions Grasset et Fasquelle, 2004 pour la présente édition
Splendeurs et misères du roman populaire, Féminité, fatalité, Michel Nathan, PUL
 Le troisième livre, (paru en avril dernier, j’ai du retard) est le premier roman de Maryse Vuillermet : Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps. Cette chercheuse à l’université Lumière Lyon 2, spécialiste de la représentation du travail, notamment ouvrier, dans la littérature romanesque, avait nourri notre imaginaire avec un récit qu’elle range elle-même dans la catégorie de l’autofiction : Naven, en 2010, et avec l’essai suivant, développement de Naven en quelque sorte, mêlant l’autobiographie à la reconstitution du destin des émigrés, immigrés, migrants, qui ont fait sa genèse : Pars ! Travaille !, en 2014. Ici, Maryse Vuillermet n’a pas tenté de s’approprier les arcanes et principes romanesques, et rejoindre ainsi la cohue des romanciers du réel. Elle a inventé ses propres solutions, frisant le documentaire, mêlant dialogues plaisants ou dérangeants et scènes vivement brossées, donnant généreusement à voir, à entendre, à s’inquiéter ou se réjouir. Maryse Vuillermet nous fait vivre chaque enjeu de vie de ses « ouvriers du temps « . Le livre suit plusieurs travailleurs frontaliers de la France vers la Suisse et retour, au cours d’une sorte de synthèse de toutes les journées, de tous les destins sur plusieurs saisons, Ã la manière dont une Julie Otsuka a pu raconter les trajectoires de ses japonaises dans Certaines n’avaient jamais vu la mer, mais sans le précieux artifice de l’accumulation des anonymats. Ici, chaque personne est nommée, approchée, comprise, chaque destin est inscrit dans son environnement économique, familial, social. Un horloger, un conducteur d’engin, une fille d’immigrés marocains, une épouse et mère de famille, etc. Bien sûr, l’universitaire est là , ses techniques d’investigations apportent tous le éléments qui feraient déjà un essai passionnant, mais ses héros et héroïnes sont vrais, proches, on les aime et les comprend. Les « pendulaires » sont lancés quotidiennement dans une marche quasi hypnotique vers le travail de l’autre côté du pays. Au delà d’une frontière impalpable. Même langue, mêmes paysages, le décalage est léger et pourtant, responsabilité identique, compétence égale, horaires similaires. Les salaires sont multipliés par deux, au bas mot. Qui résisterait ? La puissance d’attraction d’une telle offre commence à produire des effets au-delà des trente kilomètres qui furent la règle, avant Shengen. Certains commencent à se convaincre que, de Nantes ou de Bordeaux, venir chaque jour à Genève, et bien, Pourquoi pas ? L’auteure nous décrit, avec une précision de monteur de haute horlogerie, les attentes, les aspirations, les angoisses, liées à la condition des travailleurs « pendulaires ». On apprend des milliers de choses, c’est passionnant. Les descriptions du travail vertigineux des horlogers de luxe, la façon dont l’auteur détaille leur recherche inconcevable de la perfection, parviennent à nous faire toucher du doigt l’amour fétichiste que de tels objets peuvent inspirer. Je dois avouer que je comprends à présent qu’on puisse mettre 300 000 euros dans une montre. C’est un des effets imprévus de la lecture du livre de Maryse Vuillermet. Chaque métier est traité avec la même attention scientifique, combinée à une égale affection humaine pour les êtres. Cet équilibre maitrisé fait de ce texte un récit passionnant, humain et pédagogique à la fois. Bouleversant et riche d’enseignements. Dans les derniers chapitres, le rêve éveillé d’un des protagonistes donne à voir la fin apocalyptique du système. Un avertissement car, nous dit Maryse Vuillermet en épilogue, « l’histoire ne s’arrête jamais ». Au fil des parcours et des portraits, une certaine Suisse est dessinée, peu aimable avec ses immigrés, menaçante même, et c’est peut-être cela qui a compromis l’accès de Frontaliers pendulaires au prix Lettre-Frontières (attribué par des jurés suisses et français). A la lecture d’un livre aussi puissant et nécessaire, on ne peut qu’enrager d’une telle absence. Si c’est le cas, le Prix Lettre-Frontières, pour lequel j’ai une tendresse toute particulière, ne s’est pas grandi à cette occasion.
Le troisième livre, (paru en avril dernier, j’ai du retard) est le premier roman de Maryse Vuillermet : Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps. Cette chercheuse à l’université Lumière Lyon 2, spécialiste de la représentation du travail, notamment ouvrier, dans la littérature romanesque, avait nourri notre imaginaire avec un récit qu’elle range elle-même dans la catégorie de l’autofiction : Naven, en 2010, et avec l’essai suivant, développement de Naven en quelque sorte, mêlant l’autobiographie à la reconstitution du destin des émigrés, immigrés, migrants, qui ont fait sa genèse : Pars ! Travaille !, en 2014. Ici, Maryse Vuillermet n’a pas tenté de s’approprier les arcanes et principes romanesques, et rejoindre ainsi la cohue des romanciers du réel. Elle a inventé ses propres solutions, frisant le documentaire, mêlant dialogues plaisants ou dérangeants et scènes vivement brossées, donnant généreusement à voir, à entendre, à s’inquiéter ou se réjouir. Maryse Vuillermet nous fait vivre chaque enjeu de vie de ses « ouvriers du temps « . Le livre suit plusieurs travailleurs frontaliers de la France vers la Suisse et retour, au cours d’une sorte de synthèse de toutes les journées, de tous les destins sur plusieurs saisons, Ã la manière dont une Julie Otsuka a pu raconter les trajectoires de ses japonaises dans Certaines n’avaient jamais vu la mer, mais sans le précieux artifice de l’accumulation des anonymats. Ici, chaque personne est nommée, approchée, comprise, chaque destin est inscrit dans son environnement économique, familial, social. Un horloger, un conducteur d’engin, une fille d’immigrés marocains, une épouse et mère de famille, etc. Bien sûr, l’universitaire est là , ses techniques d’investigations apportent tous le éléments qui feraient déjà un essai passionnant, mais ses héros et héroïnes sont vrais, proches, on les aime et les comprend. Les « pendulaires » sont lancés quotidiennement dans une marche quasi hypnotique vers le travail de l’autre côté du pays. Au delà d’une frontière impalpable. Même langue, mêmes paysages, le décalage est léger et pourtant, responsabilité identique, compétence égale, horaires similaires. Les salaires sont multipliés par deux, au bas mot. Qui résisterait ? La puissance d’attraction d’une telle offre commence à produire des effets au-delà des trente kilomètres qui furent la règle, avant Shengen. Certains commencent à se convaincre que, de Nantes ou de Bordeaux, venir chaque jour à Genève, et bien, Pourquoi pas ? L’auteure nous décrit, avec une précision de monteur de haute horlogerie, les attentes, les aspirations, les angoisses, liées à la condition des travailleurs « pendulaires ». On apprend des milliers de choses, c’est passionnant. Les descriptions du travail vertigineux des horlogers de luxe, la façon dont l’auteur détaille leur recherche inconcevable de la perfection, parviennent à nous faire toucher du doigt l’amour fétichiste que de tels objets peuvent inspirer. Je dois avouer que je comprends à présent qu’on puisse mettre 300 000 euros dans une montre. C’est un des effets imprévus de la lecture du livre de Maryse Vuillermet. Chaque métier est traité avec la même attention scientifique, combinée à une égale affection humaine pour les êtres. Cet équilibre maitrisé fait de ce texte un récit passionnant, humain et pédagogique à la fois. Bouleversant et riche d’enseignements. Dans les derniers chapitres, le rêve éveillé d’un des protagonistes donne à voir la fin apocalyptique du système. Un avertissement car, nous dit Maryse Vuillermet en épilogue, « l’histoire ne s’arrête jamais ». Au fil des parcours et des portraits, une certaine Suisse est dessinée, peu aimable avec ses immigrés, menaçante même, et c’est peut-être cela qui a compromis l’accès de Frontaliers pendulaires au prix Lettre-Frontières (attribué par des jurés suisses et français). A la lecture d’un livre aussi puissant et nécessaire, on ne peut qu’enrager d’une telle absence. Si c’est le cas, le Prix Lettre-Frontières, pour lequel j’ai une tendresse toute particulière, ne s’est pas grandi à cette occasion.

 Heurs et malheurs du populisme, mouvement littéraire des années 30 à nos jours et prix littéraire
Heurs et malheurs du populisme, mouvement littéraire des années 30 à nos jours et prix littéraire Le populisme un mot très galvaudé aujourd’hui, « un mot qui n’a pas de chance », comme le dit Cavanna.
Le populisme un mot très galvaudé aujourd’hui, « un mot qui n’a pas de chance », comme le dit Cavanna. Vieux r?ves, grands espoirs, joie, soir?e entre amis, puis ?Place Bellecour, les jeunes de Lyon montaient sur le cheval et Louis XIV comme ceux de Paris sur la statue de la Bastille, ils klaxonnaient comme les soirs de victoire de l’OL, ?ils?n?avaient? pas les codes, ils apprendront, ?puis au Transbordeur, danses et discours, musiques et alcools.
Vieux r?ves, grands espoirs, joie, soir?e entre amis, puis ?Place Bellecour, les jeunes de Lyon montaient sur le cheval et Louis XIV comme ceux de Paris sur la statue de la Bastille, ils klaxonnaient comme les soirs de victoire de l’OL, ?ils?n?avaient? pas les codes, ils apprendront, ?puis au Transbordeur, danses et discours, musiques et alcools.